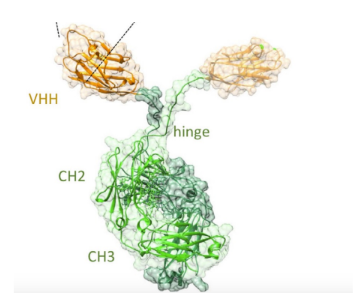Mehdi Gmar (CNRS) : « nous allons déployer une direction dédiée à l’analyse des données au sein du CNRS »
30 juin 2025

(c) Cyril Frésillon - CNRS Images
Le CNRS a signé le 25 mars un Contrat d’objectifs de moyens et de performance (COMP) avec l’État pour la période 2024-2028. Constitué de six défis transverses, il s’inscrit dans…
Vous n'êtes pas encore abonné ?
Testez gratuitement POC Media pendant un mois
- Des articles quotidiens
- Deux newsletters par semaine
- Des webinaires spécialisés
Déjà abonné ?
Connectez-vous