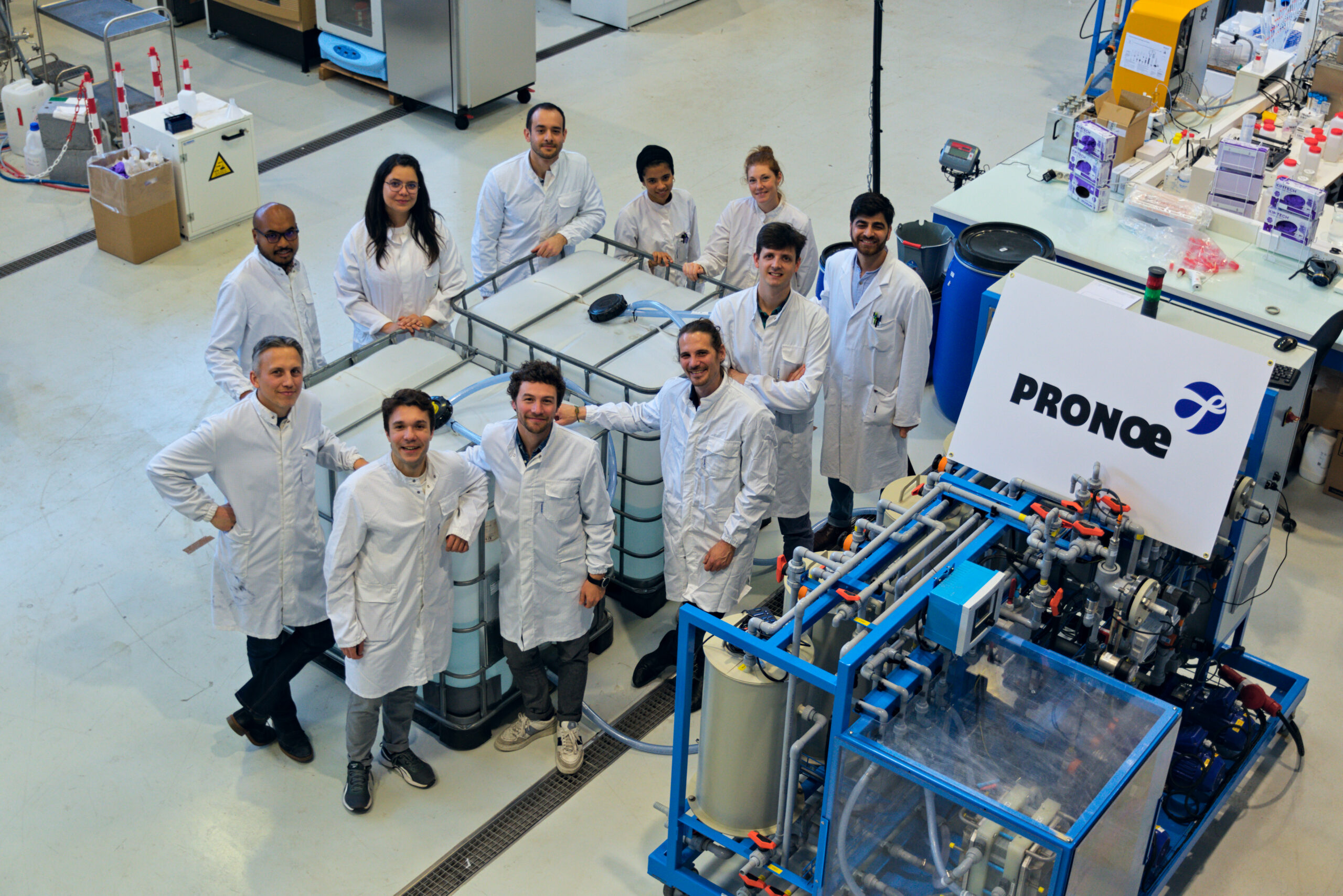Stockage de l’énergie : les solutions à changements de phase et à réactions chimiques commencent à être testées (2/2)

En 2023, le CEA Liten et le groupe GRIMS ont réalisé la preuve de concept d’une solution de stockage thermique à base de mousse métallique
Dans son récent rapport, le Conseil européen de l’innovation (EIC) pointait l’intérêt de développer des technologies de stockage d’énergie thermique pour les hautes températures, au-delà de 600 °C. Après le stockage de la chaleur sensible, deux autres pistes émergent.
Jean-François Fourmigué, ingénieur-chercheur au CEA-LITEN (Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux) où il est responsable du programme Efficacité énergétique, nous explique deux voies qui viennent compléter l’adaptation des dispositifs de stockage de chaleur sensible au-delà de 600 °C : stocker la chaleur dans son intervention dans deux phénomènes naturels à la fois très différents – l’un est physique et l’autre chimique – et similaires, car ils sont réversibles et mettent en jeu de la chaleur au moment où ils se produisent : les changements de phase solide/liquide/vapeur et certaines réactions chimiques.
Changements de phase et chaleur latente
La chaleur mise en jeu lors des changements de phase d’un matériau, c’est-à-dire lorsqu’il se liquéfie ou se solidifie, entre autres, est nommée « chaleur latente ». Entre phases solide et liquide, par exemple, la chaleur latente est la quantité d’énergie qu’il absorbe pour devenir liquide quand il dépasse sa température de fusion, puis qu’il relâche lorsqu’il redevient solide.
« Ce principe est déjà utilisé avec des sels fondus à base de nitrate dans des centrales solaires concentrées, mais les sels fondus plafonnent ce fonctionnement à –300 °C. Pour employer ce stockage aux hautes températures, il faut donc des matériaux ayant une température de fusion au-delà de 600 °C, ce qui, dans la pratique, restreint le choix aux métaux… et ne va pas sans plusieurs problèmes mécaniques », souligne Jean-François Fourmigué. Une solution, assez similaire à la problématique du stockage de la chaleur sensible à haute température, mais de façon encore plus intense, consiste à concevoir un réservoir ayant une température de fusion bien supérieure à celle du métal liquide, mais où le métal fondu puisse se resolidifier sans exercer de contraintes trop fortes sur le réservoir. Ce à quoi s’ajoute une difficulté de taille : mettre au point un échangeur de chaleur supportant ces contraintes, alors même qu’il doit être au cœur du métal de stockage dans sa phase solide pour pouvoir le chauffer à cœur afin qu’il se liquéfie entièrement et rapidement.
« Stocker la chaleur latente à haute température repose sur la mise au point de contenants adaptés à des métaux en fusion. Sans oublier des échangeurs de chaleur capables de supporter autour d’eux un métal tantôt solide et froid, tantôt liquide et très chaud. Il faut effectivement des travaux de R&D pour trouver de nouvelles pistes à la fois dans les matériaux et dans leur mise en œuvre pratique au fil des cycles de stockage-déstockage », résume Jean-François Fourmigué.
Réactions chimiques et endo/exothermie
Certaines réactions chimiques ont la particularité de mettre en jeu de la chaleur au moment où elles se produisent. Parmi elles, les réactions endothermiques absorbent de la chaleur et restituent la même quantité de chaleur quand la réaction se produit dans l’autre sens. Une façon détournée de stocker de la chaleur serait donc de trouver des composés donnant lieu à des réactions qui absorbent beaucoup de chaleur – pour être dans la plage au-delà de 600 °C – et que celles-ci soient réversibles, donc capables de se produire en sens inverse pour restituer cette même quantité de chaleur.
Ces réactions thermochimiques sont déjà utilisées à basse température, par exemple dans le démonstrateur INES. Du bromure de strontium y stocke 80 % de la chaleur provenant de panneaux solaires en été pour la restituer en hiver, à une température de 40 °C. La chaux est un autre exemple intéressant : elle permet un cycle reproductible à l’infini de déshydratation-réhydratation qui met en jeu une chaleur correspondant à la plage 350-450°C. C’est toujours trop bas pour un objectif de plus de 600 °C, mais la chaux est un bon modèle de principe, car elle est facilement disponible et peu chère.
« Les réactions thermochimiques sont pour l’instant peu étudiées pour les hautes températures. Or, on peut trouver des couples de composés qui mettent en jeu toutes plages de chaleur échangée dans un sens ou dans l’autre », souligne Jean-François Fourmigué. Des recherches pourraient donc mettre à jour des réactions candidates au stockage d’énergie à plus de 600 °C, à condition qu’elles remplissent plusieurs autres critères pour être adaptées à une mise en œuvre. « Il faut, en effet, identifier des composés peu coûteux, sans danger et assez denses, qui déclenchent une réaction réversible, à la fois chimiquement et mécaniquement. Ce qui est encore très hypothétique, c’est qu’une telle réaction puisse se produire quotidiennement plusieurs milliers de fois, dans un sens, puis dans l’autre », poursuit Jean-François Fourmigué. « Malgré ce cahier des charges touffu, les réactions thermochimiques sont une piste très intéressante et étonnamment assez peu creusée jusqu’à présent », conclut-il.
Le Conseil européen de l’innovation (EIC pour European innovation coucil) est un dispositif majeur du programme-cadre Horizon Europe. Pour renforcer la capacité d’innovation de l’Europe, il la finance avec un budget important de 10 milliards d’euros et fournit un soutien stratégique aux chercheurs, entrepreneurs, entreprises, investisseurs et responsables politiques via des prospectives sur les innovations à fort potentiel. Le rapport 2024 de l’EIC (disponible dans son intégralité en ligne) se veut une feuille de route pour l’innovation européenne.