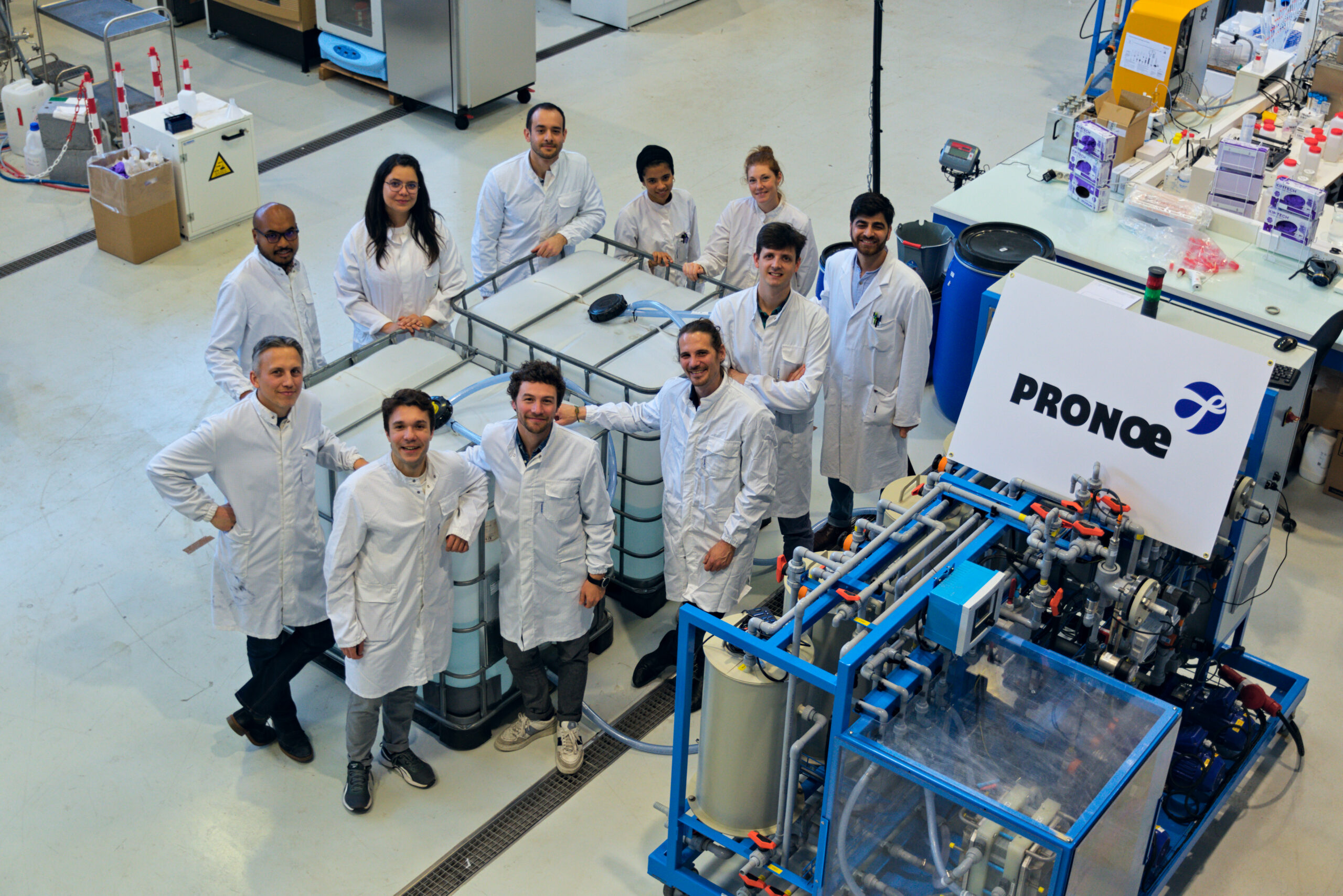Jean-François Filipot (France énergies marines) : « Le changement climatique modifie les ressources des fermes d’éoliennes »

En Europe, la France fait la course en tête dans l’éolien flottant. Fédérés au sein de France énergies marines, les acteurs de cette jeune filière poursuivent la montée en maturité de cette technologie, avec le lancement, en fin d’année dernière, de quatre nouveaux projets de recherche sur l’éolien flottant. Jean François Filipot, directeur scientifique au sein de France énergies marines, revient pour POC Media sur les verrous encore à lever pour industrialiser la filière.
Quelle est la dynamique de la filière de l’éolien flottant actuellement en France ?
Il y a eu un ralentissement il y a quelques années, à la suite, notamment, des réparations nécessaires sur des éoliennes flottantes en Angleterre, qui a causé quelques inquiétudes. Mais la filière s’est remise sur les rails en France, et une première ferme a été déployée l’année dernière (à Port-Saint-Louis-du-Rhône, par Edf). Nous attendons actuellement l’étape suivante, l’appel d’offres commercial pour l’installation de 250 MW, pour 10 à 15 machines en mer Méditerranée et à Belle-Île.
Quelle est la maturité du secteur, comparée aux autres types d’éoliennes ?
Il reste du chemin à parcourir. Nous devons déjà réussir à réduire le coût de l’électricité produite par ces éoliennes. Il était à 150 € le MW il y a quelques années, et est aujourd’hui autour de 90 €. Nous nous approchons rapidement du prix de l’éolien posé, qui est autour de 50 €. En parallèle, les éoliennes posées peuvent atteindre des profondeurs de plus en plus importantes (jusqu’à 70 m à l’heure actuelle).
Quels sont les principaux verrous technologiques qui freinent encore l’industrialisation de la filière ?
Le premier verrou est logistique. Il faut être capable d’assembler une ferme d’éoliennes flottantes sur une saison, entre mai et septembre. La rapidité d’assemblage est devenue centrale pour les industriels. Un deuxième verrou concerne le coût de la maintenance. L’éolien posé bénéficie de navires dédiés à la maintenance qui permettent de déposer des composants lourds en pleine mer, car il est appuyé sur des jambes. L’éolien flottant ne possède pas ce type de navires (la profondeur est trop importante), et les opérateurs des fermes doivent rapporter les éoliennes flottantes jusqu’au port pour les réparer ou les changer, ce qui coûte très cher. La solution passe par une meilleure estimation de l’usure des pièces, donc une meilleure instrumentation des machines. Nous développons, par exemple, un jumeau numérique de l’éolien flottant, qui reproduit le comportement des machines dans les conditions réelles de vent et de vagues rencontrées sur site, afin de mieux estimer la force de ces éléments sur les structures et l’usure des matériaux. À l’avenir, nous allons devoir réussir à interconnecter différents « jumeaux » entre eux, de la machine, des réseaux électriques, des vagues… pour gagner en efficacité.

Mieux connaître l’activité des vagues fait partie des quatre projets de recherche lancés en fin d’année dernière par France énergies marines. Que reste-t-il à comprendre sur les vagues et les vents ?
Ce projet porte sur la connaissance des effets du changement climatique sur les conditions de vents et vagues moyennes et extrêmes. Le changement climatique peut modifier la ressource en vent des fermes d’éoliennes. Nous avons aussi lancé des projets sur la mesure de l’impact des fermes sur l’environnement, notamment sur les poissons. Nous nous intéressons aussi à la façon dont le biofouling affecte les fermes. Tous ces phénomènes affectent la production des machines.
Ces travaux conduisent-ils à développer de nouveaux composants, turbines ou modèles de fermes ?
Oui, nous travaillons, par exemple, sur les lignes d’ancrage qui relient les éoliennes au sol marin. Les acteurs du pétrole utilisent des chaînes en acier, qu’ils doublent par sécurité. Nous sommes en train de tester des lignes d’ancrage en nylon, qui ont l’avantage d’être plus légères et moins chères. Elles sont aussi plus élastiques, donc elles amortissent davantage les forces. En revanche, elles ont des comportements compliqués, elles ne reviennent pas à leur longueur initiale lorsqu’elles ont été tendues, et il faut savoir modéliser ce comportement. Enfin, nous travaillons sur la façon dont les turbines s’adaptent au flotteur, même s’il s’agit d’une technologie émergente. Sur les flotteurs, les éoliennes sont davantage sollicitées et elles oscillent plus. Nous souhaitons contrôler cela, pour éviter les risques de casse. Nous développons des contrôleurs capables de mieux gérer la vitesse et l’angle des pales pour limiter les mouvements du flotteur en agissant sur la turbine.
Quels sont les besoins de R&D que vous anticipez sur le marché de l’éolien flottant ?
Nous constatons un accroissement de la taille des machines. Aujourd’hui, elles affichent des puissances de 14 MW. Demain, ce sera 20 MW. Elles seront donc plus hautes. Or, nous connaissons moins bien les vents à ces hauteurs et les machines seront plus flexibles, ce que nous devons savoir modéliser.
Quels sont les atouts scientifiques de la France dans cette filière ?
FEM est constituée de la plus grande équipe de R&D dédiée à l’éolien en mer et fédère déjà les compétences des acteurs académiques sur l’éolien. Nous apportons aussi des moyens, comme le mât de mesure à Fécamp. Le mât est équipé de différents équipements, comme un lidar (mesure du vent), et nous permet de mesurer le comportement des oiseaux, de la force du vent à des hauteurs variables, ou encore des vagues.